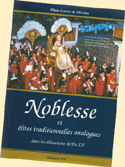|
|
Plinio Corrêa de Oliveira
Noblesse et élites traditionnelles analogues dans les allocutions de Pie XII au Patriciat et à la Noblesse romaine |
|||||||||||
Pour faciliter la lecture, les références aux allocutions pontificales ont été simplifiées: est désigné d'abord le sigle correspondant (voir ci-dessous), puis l'année où l'allocution a été prononcée. PNR = Allocution au Patriciat et à la Noblesse romaine GNP = Allocution à la Garde noble pontificale Certains extraits des documents cités ont été soulignés en caractères gras par l'auteur. Titre original: Nobreza e elites tradicionais análogas nas Alocuções de Pio XII ao Patriciado e à Nobreza Romana (Editora Civilização, Lisboa, 1993). Traduit du portugais par Catherine Goyard 1ère édition française: Editions Albatros, 1993. Cet ouvrage a aussi été publié en italien (Marzorati Editore, Milan), en espagnol (Editorial Fernando III, Madrid) et en anglais (Hamilton Press, Lanham MD, USA). APPENDICE III
Les formes de gouvernement selon la doctrine sociale de l'Eglise:en thèse et in concretoA — Les différentes formes de gouvernement: monarchie, aristocratie et démocratie1. Régime monarchique: la meilleure forme de gouvernementAu Consistoire secret du 17 juin 1793 sur l'exécution du roi Louis XVI, le pape Pie VI déclarait:
(1) Pii VI Pont. Max. Acta. Typis S. Congreg. de Propaganda Fide, Romae, 1871, vol. II, p. 17. 2. L'Eglise ne s'oppose à aucune forme de gouvernement qui soit juste et réponde au bien communDans l'encyclique Diuturnum illud du 29 juin 1881, Léon XIII affirmait :
Le 1er novembre 1885, dans son encyclique Immortale Dei, il ajoutait:
(2) Acta Sanctae Sedis, Typis Polyglottae Officinae, Romae, 1881,vol. XIV, p.5. (3) Acta Sanctae Sedis, Typis Polyglottae Officinae, Romae, 1885, vol. XVIII, p. 162, 174. Dans ces textes, Léon XIII expose le cas d'une nation qui, sans aucune violation du principe d'autorité ou des droits acquis, se trouve dans la contingence de choisir entre la forme de gouvernement déjà existante et une autre. Ses enseignements sont aussi valables, mutatis mutandis, pour les particuliers qui se trouvent devant un choix semblable: au moment de voter, par exemple lors d'un référendum, pour une monarchie, une république aristocratique ou une république démocratique; ou encore pour choisir un parti politique auquel s'affilier. 3. Une forme de gouvernement peut être préférée à une autre, comme s'adaptant mieux au caractère ou aux moeurs du peuple concernéDans l'encyclique Au milieu des sollicitudes du 16 février 1892, Léon IIII poursuivait:
(4) Acta Sanctae Sedis, ex Typographia Polyglotta, Romae, 1891-92, vol. XXIV, p. 523. 4. Erreur du Sillon: seule la démocratie inaugurera le règne de la parfaite justicePar sa Lettre Notre charge apostolique du 25 août 1910, saint Pie X enseignait:
(5) Acta Apostolicae Sedis, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1910, vol. II, p. 618-619. 5. L'Eglise catholique s'accommode sans difficulté des différentes formes de gouvernementPie XI, à son tour, déclarait dans l'encyclique Dilectissima Nobis du 3 juin 1933:
(6) Acta Apostolicae Sedis, vol. XXV, n° 10, 5-6-1933, p. 262. 6. La véritable démocratie n'est pas incompatible avec la monarchieEn 1944, dans son Message radiodiffusé de Noël, Pie XII ajoutait:
(6) Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Tipografia Poliglotta Vaticana, vol. VI, p. 238 et 240. 7. L'Eglise catholique admet toute forme de gouvernement ne s'opposant pas aux droits divins et humainsLe même Pontife assurait dans son allocution au Consistoire secret extraordinaire du 14 février 1949:
(7) Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Tipografia Poliglotta Vaticana, vol. X, p. 381. 8. Pour déterminer la structure politique d'un pays, il faut tenir compte des circonstances de chaque peupleDans l'encyclique Pacem in Terris du 11 avril 1963, Jean XXIII déclarait:
(8) Acta Apostolicae Sedis, vol.V, n° 5, 20-4-1963, p. 276. 9. L'Eglise ne manifeste aucune préférence envers un système politique ou une solution institutionnelleLe 30 décembre 1987, dans son encyclique Sollicitudo Rei Socialis, Jean-Paul II ajoutait:
Et dans l'encyclique Centesimus Annus du 1er mai 1991, il poursuivait:
(9) Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXX, n° 5, 7-5-1988, p. 570. (10) Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXXIII, n° 10, 9-10-1991, p. 852. 10. La structure fondamentale de la communauté politique: fruit du génie de chaque peuple et de son histoireEn 1965, le Concile Vativan II publiait la Constitution Gaudium et Spes d'où l'on extrait ce passage:
(11) Sacrosanctum OEcumenicum Concilium Vaticanum II, Constitutiones, Decreta, Declarationes, Typis Polyglottis Vaticanis, 1974, p. 801, 802 et 803. 11. La monarchie est en soi le meilleur des régimes, parce qu'elle favorise davantage la paixEn considération de la place de choix que la doctrine de saint Thomas d'Aquin occupe dans l'enseignement catholique traditionnel, il est opportun d'ajouter, aux textes pontificaux déjà cités comme témoignage de la doctrine sociale de l'Eglise en cette matière, quelques extraits représentatifs de sa pensée. Dans De Regimine Principum, saint Thomas enseigne:
(12) SAINT THOMAS D'AQUIN, De Regimine Principum ad Regem Cypri, Livre I, ch. II,Marietti, Rome, 1950, p. 259-260. A cette explication du Docteur Angélique, l'éminent thomiste P. Victorino Rodriguez O.P. (13) ajoute le commentaire suivant, enrichi d'autres textes de saint Thomas: (13) Le P. Victorino RODRIGUEZ, disciple fidèle du célèbre maître de philosophie scolastique, le P. Santiago Ramírez, OP., a déjà publié plus de 250 études, sous forme d'articles ou de livres, sur des thèmes philosophiques et théologiques. Parmi ses oeuvres, se distinguent les Temas-llave del Humanismo Cristiano et les Estudios de Antropologia Teológica. Le P. Victorino Rodriguez est actuellement prieur du monastère Santo Domingo el Real, à Madrid. Il a été professeur à la faculté de Théologie de Saint-Etienne à Salamanque, et titulaire d'une chaire à l'Université pontificale de cette même ville. Il exerce à présent la charge de professeur au Conseil supérieur de la recherche scientifique à Madrid. Il appartient aussi à l'Académie royale de docteurs, à Madrid, ainsi qu'à l'Académie romaine pontificale de théologie.
(14) Saint Thomas d’Aquin, El Régimen Político ; introduction et commentaires du P. V. Rodríguez, Fuerza Nueva Editorial, Madrid, 1978, p. 37-39. 12. La meilleure façon de modérer et d'affermir la monarchie est de l'entourer d'aristocratie et de démocratieA propos de la pensée de saint Thomas d'Aquin sur la forme mixte de gouvernement, le P. Victorino Rodriguez fait le commentaire suivant:
(15) A propos du terme «démocratie», le P. Victôrino Rodriguez précise: «Ce sens péjoratif de la "démocratie" dans l'ouvrage De Regimine Principum est maintenu dans les commentaires aux livres Ethique et Politique d'Aristote, où elle est appelée aussi gouvernement "plébéien", gouvernement "populaire", gouvernement "des pauvres", où la majorité numérique des citoyens s'impose à la minorité plus qualifiée et, en conséquence, l'opprime injustement (d'où le sens péjoratif de cette démocratie). [...] Cependant, dans la Somme Théologique, quand il est fait allusion aux formes de gouvernement (y. gr. I-II, 95, 4; II-II, 61, 2), seule la tyrannie figure comme forme incorrecte de gouvernement, et non l'oligarchie ni la démocratie qui peuvent être plus ou moins correctes» (ibid., p. 31 et 33). ( 16) Cf. in El Régimen Político, p. 61 et 63.13. Une constitution démocratique doit assumer et protéger les valeurs de la foi chrétienne, sans quoi elle ne pourra subsisterDevant les circonstances particulières de notre époque, il est opportun de citer l'observation judicieuse que fait le cardinal Ratzinger, préfet de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, dans une entrevue accordée au journal El Mercurio, de Santiago du Chili (12-6-88):
B — Formes de gouvernement: les principes abstraits et leur influence sur la formation d'une mentalité politiqueQuant aux formes de gouvernement, il convient d'ajouter quelques considérations aux documents pontificaux et aux enseignements de saint Thomas mentionnés dans ce livre et surtout dans cet appendice. 1. Utilité concrète des principes abstraitsUne remarque s'impose tout d'abord. Ces documents énoncent surtout des principes abstraits. Et bien des gens pensent aujourd'hui que les abstractions n'ont aucune utilité en matières politique, sociale ou économique. Ils remettent par conséquent en question ou nient d'emblée la portée de ces documents. Or une observation même sommaire de la réalité montre clairement combien le contraire est vrai. En ce qui concerne le choix entre les trois formes de gouvernement par exemple, la mentalité de la plupart de nos contemporains est fortement influencée, souvent même de façon prépondérante, par des principes abstraits:
(17) Cf. Chapitre VII. Or, très nombreux sont ceux qui aujourd'hui déterminent leur préférence pour une de ces formes de gouvernement en fonction d'un principe abstrait (d'ailleurs condamné par saint Pie X) selon lequel la monarchie, et implicitement aussi l'aristocratie, seraient des formes de gouvernement injustes parce qu'elles admettent une inégalité politique et sociale entre les habitants d'un même pays. Ce qui à son tour découle d'un principe métaphysique: toute inégalité entre les hommes serait intrinsèquement injuste. 2. Position des catholiques face aux formes de gouvernementLes textes des Papes et de saint Thomas cités plus haut montrent clairement que ces principes radicalement égalitaires sont formellement opposés à la façon correcte de penser d'un catholique (18). (18) Un autre docteur de l'Eglise, saint François de Sales, affirme que la monarchie, en tant que forme de gouvernement, possède un degré élevé de perfection, car elle est plus conforme à l'ordre de la création:
Selon l'enseignement des Souverains Pontifes, la monarchie (et implicitement l'aristocratie) est non seulement une forme de gouvernement juste et efficace pour promouvoir le bien commun mais en outre, d'après le grand saint Thomas et l'indéniable assertion de Pie VI, elle est la meilleure. De tout ce qui vient d'être présenté, il résulte que:
(19) «Presque tous les auteurs scolastiques, les anciens comme les modernes, et de nombreux auteurs non-scolastiques, déclarent que la monarchie tempérée est la forme à préférer in abstracto» (P. Irineu GONZALES MORAL, SI, Philosofiae Scholasticae Summa, BAC, Madrid, 1952, y. III, p. 836-837). 3. Effet social et culturel de la mentalité aristocratique et monarchiqueCes principes politiques se répercutent dans la configuration de la société, de la culture et de l'économie d'un peuple. En raison de la cohésion intrinsèque et naturelle existant entre ces divers domaines et la politique, la précellence d'un certain esprit aristocratique et monarchique doit marquer — toujours dans la mesure du possible —tous les niveaux de la société et toutes les manifestations de l'activité du peuple, quelle que soit la forme de gouvernement adoptée. Par exemple, un respect particulièrement marqué du père dans la famille, du maître à l'école, du professeur ou du recteur à l'université, du propriétaire et des directeurs dans l'entreprise etc, doit refléter cet esprit aristocratique et monarchique dans toutes les sociétés, jusque dans les Etats démocratiques. Pie XII a déclaré dans ce sens que, même dans les Etats républicains, la société devait avoir certaines institutions authentiquement aristocratiques et il a exalté le rôle des familles saillantes qui «donnent le ton au village, à la cité, à la région et au pays entier (20).» C'est cet enseignement que réaffirma le regretté Souverain Pontife au Patriciat et à la Noblesse romaine, aussi bien dans les allocutions prononcées au temps de la monarchie italienne (de 1940 à 1946) qu'au temps de la république (de 1947 à 1952 et en 1958); ce qui prouve que le changement de forme de gouvernement n'altère en rien la mission sociale de l'aristocratie. (20) PNR 1946; cf. Chapitre V. Il faut encore rappeler que la mentalité aristocratique et monarchique permet l'éclosion d'un art, d'une littérature, d'un style de vie en somme, typiquement populaire dans les couches les plus modestes de la population et respectivement bourgeois ou aristocratique dans les autres. Les Etats et les sociétés européennes d'avant 1789 ont connu ces diversités. Chacune d'elles reflétait à sa manière l'unité et la variété de l'esprit du pays, esprit qui produisit à tous les niveaux sociaux des oeuvres magnifiques, soigneusement conservées de nos jours dans des collections privées ainsi que dans des musées et bibliothèques de qualité: qu'il s'agisse du mobilier et des objets décoratifs de familles travaillant de leurs mains, ou des expressions culturelles issues des milieux supérieurs. L'art populaire des périodes historiques antérieures à l'ère égalitaire: que d'éloges véritables, justes et même émouvants pourrait-on en faire! Un art comme d'ailleurs une culture authentiques, mais typiquement populaires et conformes à cette dernière condition, déplaisent à l'esprit révolutionnaire de notre siècle; et cela à tel point que si l'état d'une famille ou d'un groupe du peuple s'améliore considérablement à la suite de circonstances imprévues de l'économie moderne, l'égalitarisme ne cherche pas à ce que cette famille se raffine à l'intérieur de sa condition modeste, mais il tend à la faire passer immédiatement à une condition supérieure pour laquelle il lui faudrait souvent de longues décennies d'amélioration personnelle. D'où les disproportions et les disparités fréquemment relevées chez les parvenus. Voilà quelques exemples parmi d'autres — innombrables — de l'influence des principes abstraits sur l'histoire de l'immense aire culturelle que représente l'Occident. 4. Légitimité des principes antiégalitairesL'opposition entre la doctrine sociale de l'Eglise et l'égalitarisme radical, si puissant chez nombre de nos contemporains dès qu'il s'agit de choisir une forme de gouvernement, a été étudiée jusqu'ici. C'est en fait sur la base de ce principe — l'égalitarisme — que se sont produites, à la manière d'un ouragan ou d'un tremblement de terre, les transformations les plus notables de l'Occident. Il convient maintenant de dire un mot sur la légitimité des principes antiégalitaires appliqués aux formes de gouvernement. Ces principes sont justes lorsque, inspirés par l'enseignement chrétien, ils contrastent avec l'égalitarisme radical mais aussi lorsqu'ils admettent et préfèrent les expressions politiques et sociales basées sur une inégalité harmonieuse et équitable des classes. En résumé, ces principes reconnaissent avant tout l'égalité entre tous les hommes en ce qui concerne les droits qui sont les leurs par le simple fait d'être homme; mais ils affirment aussi la légitimité des inégalités accidentelles qui s'érigent parmi les hommes sur la diversité des vertus, des dons intellectuels, des aptitudes physiques etc.; inégalités qui n'existent pas seulement entre individus mais aussi entre familles en vertu du beau principe énoncé par Pie XII, qui sera seulement rappelé ici: «Les inégalités sociales, y compris celles qui sont liées à la naissance, sont inévitables; la nature bienveillante et la bénédiction de Dieu sur l'humanité illuminent et protègent les berceaux, les embrassent mais ne les nivellent pas (21).» (21) PNR 1942. Toujours selon ces principes, les inégalités tendent à se perpétuer, à se raffiner —sans pour autant tomber dans l'exagération — au long des générations et des siècles, donnant même naissance à une législation sévère, coutumière ou écrite, qui punit par l'exclusion de la noblesse ceux qui s'en rendent indignes et en ouvre les portes aux élites analogues authentiquement traditionnelles. Les inégalités entre personnes, familles et classes sociales étant donc légitimes, on en déduit facilement la légitimité ainsi que l'excellence des formes de gouvernement qui préservent et favorisent — de façon équilibrée et organique — ces inégalités naturelles, à savoir la monarchie et l'aristocratie, dans leur forme pure comme dans leur forme mitigée. 5. Effets de la mentalité politique sur les groupes sociaux intermédiairesLe sujet, beau et complexe, des formes de gouvernement vient d'être considéré dans certains de ses aspects les plus importants; en guise de complément, différentes influences de la mentalité inhérente à chacune de ces formes sur la vie sociale, culturelle et économique ont aussi été analysées. Il faudrait maintenant étudier les conséquences produites par cette mentalité sur les groupes sociaux intermédiaires entre l'Etat et l'individu qui façonnèrent les nations de l'Europe pré-révolutionnaire en ensembles puissants de «sociétés organiques». Mais l'ampleur et la richesse de ce thème ne permettent pas à cet ouvrage de le contenir. Si tous nos contemporains avaient la notion exacte de ce que représentèrent — dans cette «société organique» — une région, un fief, une commune, une grande corporation autonome etc, les prémisses de nombreux raisonnements sur les formes de gouvernement gagneraient en clarté. Les discussions à ce propos — tantôt passionnées, tantôt somnolentes — retrouveraient elles-mêmes leur fil directeur et leur utilité pratique. «Sociétés organiques», voilà d'ailleurs un sujet qui ne manque pas d'opportunité. Les réflexions et les tentatives faites pour transformer l'Europe en un conglomérat politique, social, culturel, militaire et économique ont provoqué l'exacerbation des régionalismes ou des centralismes qui, observés dans les informations chaotiques de la presse contemporaine, ressemblent à autant de vaisseaux voguant à la dérive en pleine mer d'indécision, sans boussole, timon ni lest. De cette carence de notions fondamentales résulte un manque d'harmonie navrant entre les parties qui menace l'ensemble de dislocation et de ruine. C — Révolution française: prototype de république révolutionnaireIl a jusqu'à présent été question de la mentalité monarchique. On peut aisément se faire une idée de son contraire, la mentalité républicaine «révolutionnaire», c'est-à-dire celle émanant d'un mouvement révolutionnaire conduit en faveur de la république, comme par exemple la Révolution française. Mais pour bien la comprendre, il faut d'abord la distinguer nettement de la mentalité du républicain «non révolutionnaire»: celui qui, tout en acceptant la république pour son pays parce que les circonstances l'imposent, comme cela vient d'être exposé un peu plus haut, garde cependant une mentalité monarchique. Il devient alors nécessaire d'analyser en quoi consiste la «Révolution (22)» et ce qui la différencie de la république prise, de façon froide et abstraite, dans le sens thomiste du mot caractérisant une forme légitime de gouvernement. (22) [N. du T.: Le mot «Révolution» est utilisé ici par l'auteur pour désigner l'ensemble du mouvement historique qui tend à détruire la civilisation chrétienne depuis le XVe siècle (cf. note 1 p. 74). Comme les lecteurs français sont habitués à attribuer à l'expression «la Révolution» le sens exclusif de la Révolution française, et que dans cet appendice l'auteur parle de l'une et de l'autre, le traducteur a choisi, pour faciliter la lecture, d'écrire «Révolution» (entre guillemets) quand il s'agit de l'ensemble du processus historique et «la Révolution française» (in extenso et sans guillemets) quand il se réfère à l'étape révolutionnaire de 1789.] Lors de la Révolution française, cette distinction était si claire que plus d'un qui moururent sur les marches du trône après s'être battus héroïquement pour la monarchie, appartenaient à la fameuse Garde suisse et avaient donc la qualité de citoyens d'une république: les Républiques helvétiques dont ils étaient ressortissants. En donnant leur vie pour une monarchie, les Cent-Suisses ne se considéraient pas en contradiction avec leurs préférences pour la forme de gouvernement républicaine en ce qui concernait leur petit pays. De son côté, le roi de France n'estimait pas compromettre la solidité de son trône en admettant, parmi ses gardes les plus fidèles, ceux qui avaient opté pour la république dans leur propre pays. Il s'agit maintenant de considérer la relation existant entre la «Révolution» et la forme de gouvernement qu'elle a engendrée, la république révolutionnaire (à ne pas confondre avec la république non révolutionnaire, forme de gouvernement légitime décrite dans les documents pontificaux et l'oeuvre de saint Thomas). On verra en même temps comment l'opinion publique peut être amenée à accepter cette république révolutionnaire par l'action de courants pseudomodérés favorables à la «Révolution». En guise d'illustration historique, un exemple prototype a été choisi: la Révolution française. 1. La «Révolution» et ses éléments essentielsa) Une impulsion au service d'une idéologieDans la «Révolution», il faut tout d'abord distinguer deux éléments: C'est une idéologie et cette idéologie dispose d'une impulsion. Aussi bien dans son idéologie que dans son impulsion, la «Révolution» est radicale et totalitaire. En tant qu'idéologie, ce totalitarisme radical consiste à mener tous les principes constitutifs de sa doctrine jusqu'à leur extrême conséquence. En tant qu'impulsion, il transpose invariablement les principes révolutionnaires aux actions, moeurs et institutions où les éléments idéologiques respectifs sont totalement appliqués à la réalité concrète. L'étape suprême de l'impulsion révolutionnaire peut être caractérisée ainsi: obtenir tout, tout de suite et pour toujours. Le fait que l'un des éléments essentiels de la «Révolution» soit une impulsion ne signifie pas qu'elle soit impulsive dans l'acception vulgaire du mot, c'est-à-dire irréfléchie, animée par l'impatience et l'intempérance. Le révolutionnaire modèle sait au contraire que les obstacles auxquels il se heurte sont souvent impossibles à enlever de force. Il sait qu'il doit fréquemment temporiser, faire preuve de souplesse, reculer et faire même des concessions sous peine d'essuyer d'humiliantes et nuisibles défaites. Pour éviter des ennuis majeurs, il fera toutes les marches arrière indispensables. Mais, dès que les circonstances lui seront favorables, il reprendra obstinément sa marche en avant avec toute la rapidité possible ou toute la lenteur nécessaire (23). (23) Cette flexibilité tactique de la «Révolution» a été décrite de manière synthétique et imagée par Mao-Tsé-Toung: «Si l'ennemi attaque, je retraite. / Si l'ennemi retraite, je le poursuis. Si l'ennemi s'arrête, je le harcèle. / Si l'ennemi se regroupe, je me disperse» (Pierre DARCOURT, «Mao le maquisard», in Miroir de l' histoire, n° 267, mars 1972, p. 98). En appliquant ses principes à tous les domaines de l'être et de l'agir des hommes ou des sociétés, la «Révolution» montre aussi sa totalité et sa radicalité: il suffit de voir les transformations subies par le monde durant ces cent dernières années. «Liberté-égalité-fraternité». Cette trilogie a transformé graduellement les individus, les familles, les nations. On ne trouve pour ainsi dire plus de champ de l'activité humaine qui n'ait été marqué, d'une façon ou d'une autre, par la marche victorieuse d'un des principes de cette trilogie. En tenant compte des règles de prudence énoncées ci-dessus, il est possible de dire que la marche de la «Révolution» se solde par une avance presque constante. Qu'est-il advenu par exemple de la famille au cours du dernier siècle? L'autorité parentale souffre d'un déclin incessant: égalité. Les liens entre conjoints se distendent de plus en plus: liberté. Et dans les salles de classe des écoles, lycées ou universités? Les marques de respect des élèves envers leurs professeurs sont de plus en plus ténues: égalité. Les professeurs ont même tendance à se mettre le plus possible au niveau de leurs élèves: égalité, fraternité. Bien d'autres domaines susciteraient les mêmes observations: les rapports entre gouvernants et gouvernés, entre patrons et ouvriers, ou même entre dignitaires ecclésiastiques et fidèles. Si l'on entreprenait d'énumérer d'une façon à peu près complète les transformations qui, sous le souffle de la trilogie révolutionnaire, se sont produites dans le monde, la liste risquerait de ne jamais terminer. b) Un autre élément de la «Révolution»: son emprise sur la multitudeC'est la multitude, oui, la multitude innombrable — conduite soit par conviction, soit par mimétisme, soit encore par la peur de subir les slogans railleurs dont les révolutionnaires mitraillent leurs opposants — qui mène ou simplement tolère l'offensive impunément dominatrice de la propagande révolutionnaire, orale ou écrite. Si la «Révolution» n'était qu'une simple idéologie servie par une impulsion, il lui manquerait l'importance historique. C'est son emprise sur la multitude qui constitue le facteur le plus important de sa réussite. 2. L'opinion catholique face à la Révolution française: dissensionsTout cela explique que la Révolution française soit en général apparue, presque dès ses débuts, sous la forme d'une foule intoxiquée psychologiquement par la trilogie révolutionnaire qui déchaînait en elle un enthousiasme impulsif et enivrant; une foule qui, sous l'action de cette ivresse, cherchait à arriver le plus vite possible aux ultimes conséquences (il faut lire aux plus violentes, aux plus despotiques, aux plus sanglantes conséquences) de la trilogie et qui, pour cela, renversait tout ce qui représentait la foi, l'autorité, la hiérarchie, les structures politiques, sociales ou économiques. Dans les dernières contorsions de sa phase la plus ensanglantée, après avoir cassé statues et autels, fermé les églises, persécuté les ministres de Dieu, détrôné et exécuté le roi et la reine, déclaré la noblesse abolie, condamné un bon nombre de nobles à la peine de mort et ainsi atteint son but d'implanter un monde nouveau en tout, tout de suite et pour toujours, la Révolution française fut sur le point de réaliser ce que l'un de ses plus fameux précurseurs, Diderot, avait écrit de façon si caractéristique: «Et ses mains, ourdissant les entrailles du prêtre, en feraient un cordon pour le dernier des rois (24).» (24) DIDEROT, Les Eleuthéromanes, in Hippolyte TAINE, Les origines de la France contemporaine, Robert Laffont, 1986, p. 165. a) Différents points de vue des catholiques sur la Révolution françaiseFace à une telle pluralité d'aspects dans le phénomène révolutionnaire — dans le chaos révolutionnaire — il est compréhensible que ce soit généralement l'aspect global de la Révolution française qui saute d'abord aux yeux. La trilogie, au caractère pour ainsi dire bénin et équitable, ou les actions subversives, sanguinaires et fanatiques qui pointent dans ses ambiguïtés, n'apparaissent qu'ensuite. Il n'est donc pas étonnant qu'un grand nombre de catholiques se soient demandé que penser de cette révolution en tant que catholiques. Certains distinguent la doctrine révolutionnaire exprimée par cette trilogie ambiguë et les faits qui en ont résulté: ils ne veulent en accepter qu'une interprétation bienveillante. Ils sympathisent ainsi avec la Révolution française bien qu'ils fustigent, avec une certaine indolence cependant, ses crimes. D'autres l'envisagent comme l'ignoble responsable des cruautés et des injustices que nous venons d'énumérer. Choisissant l'interprétation très défavorable à laquelle se prête cette trilogie, ils la dénoncent comme le fruit criminel d'une conjuration satanique, tramée et mise en oeuvre pour modeler les individus, les nations et la civilisation chrétienne elle-même, — qui les dirigeait encore peu de temps auparavant — selon l'esprit et la devise du premier révolutionnaire qui a osé crier dans les immensités célestes son non serviam (25). (25) Voilà ce que le Cardinal Billot écrit sur le caractère satanique de la Révolution française:
Pour les défenseurs de cette analyse de la Révolution française, l'unique attitude d'un catholique devant une telle révolte était de proclamer le cri de fidélité des anges de lumière fidèles à saint Michel: «Quis ut Deus»; et de déclencher sur la terre un praelio magnum semblable à celui des anges dans le ciel pour dissoudre les repaires ténébreux où se complote la «Révolution», punir sévèrement ses responsables, mettre en déroute les phalanges des conspirateurs, éliminer ses «conquêtes» soi-disant méritoires, redresser les autels, rouvrir les églises, replacer les statues, rétablir le culte divin, restaurer le trône, la noblesse et toutes les formes de hiérarchie et d'autorité. Enfin, il fallait renouer le fil de l'histoire cassé par l'ignominie révolutionnaire et reprendre le cours des événements bassement fourvoyé. b) La Révolution française vue par Pie VI
Lors de son allocution sur la décapitation de Louis XVI, le Pape Pie VI fit de la Révolution française une analyse empreinte de grandeur surnaturelle et prophétique:
(26) Pii VI Pont. Max. Acta, Typis S. Congreg. De Propaganda Fide, Romae, 1871, vol. II, p. 17, 25-26, 29-30, 33. Le phénomène révolutionnaire est ici saisi dans son ensemble: l'idéologie, l'impulsion, la multitude innombrable qui emplissait rues et places, les comploteurs impies et occultes, les objectifs radicaux et ultimes qui séduisirent les révolutionnaires du début jusqu'à la fin. Ces objectifs apparurent derrière les slogans initiaux parfois benoîts lorsque la révolution, se dévoilant peu à peu dans sa totalité, finit par atteindre son terme horrifiant. c) Complicité des «modérés» avec la radicalité de la RévolutionCette analyse de la Révolution française ne nie pas l'existence de différentes nuances en son sein. On ne peut ainsi identifier les royalistes libéraux des débuts, les Feuillants — qui, par rapport aux partisans inconditionnels de l'Ancien Régime, faisaient en quelque sorte figure de révolutionnaires — avec les Girondins. Ceux-ci défendaient en général une république opposée au clergé et à la noblesse mais favorable à un régime social et économique libéral, ce qui aurait mis à l'abri de l'ouragan la libre initiative, la propriété privée, etc. La position girondine avait tout pour être considérée comme radicalement révolutionnaire non seulement par les contre-révolutionnaires déterminés (émigrés, chouans et autres membres de l'insurrection royale) mais aussi par les Feuillants. Elle provoquait, de l'autre côté, la colère de la Montagne ultra-intransigeante qui réclamait elle-aussi l'abolition de la royauté, la persécution radicale et sanglante du clergé ainsi que de la noblesse, mais jetait également un regard menaçant sur les fortunes saillantes de la bourgeoisie. En analysant cette succession de nuances—ou d'étapes — depuis les Feuillants jusqu'aux membres du Comité de Salut Public et leurs hordes d'admirateurs, on remarque que chacune se situe nettement à gauche par rapport à la précédente et apparaît ultraconservatrice au regard de la suivante. Il en fut ainsi jusqu'en 1795, jusqu'au dernier souffle exhalé par une révolution désormais moribonde, la révolution communiste de Babeuf: rien ne pouvait plus être conçu à sa gauche sinon le chaos et le vide; sur sa droite, un babouviste pouvait voir l'enfilade de toutes les tendances qui l'avaient précédé. Mais évaluer valablement le phénomène révolutionnaire à partir de ses nuances, suppose nécessairement de prendre en ligne de compte — au moins implicitement —la coexistence contradictoire, même dans la plupart des esprits les plus pondérés, de réels desseins de modération à côté d'indulgences inexplicables, allant parfois jusqu'à la nette sympathie, envers les crimes et criminels de la Révolution française. Cette présence simultanée de penchants pour la mesure et de connivences révolutionnaires, dans la mentalité des «modérés» tout au long des différentes étapes de la Révolution française, amena l'un des plus fougueux apologistes de cette dernière — Clémenceau — à se dérober aux contradictions qui lui étaient reprochées en affirmant sommairement que «la Révolution est un bloc» (27) dont les fissures et les désaccords ne sont que des apparences. Autrement dit, pour porter sur elle un jugement fondé, il ne faut pas l'identifier à l'une de ses nuances mais apprécier ce mélange d'inclinations, de doctrines et de programmes dont elle est l'évidente résultante. (27) François Furet, Mona Ozouf, Dictionnaire Critique de la Révolution française, Flammarion, Paris, 1988, p. 980. La formule de Clémenceau peut sembler attrayante. Il s'agit cependant d'une description encore insuffisante de la réalité historique. En effet, un principe d'importance capitale ordonne la confusion apparente de ce mélange. Depuis le début, et presque jusqu'à Babeuf, chaque étape de la Révolution française cherche à détruire une partie du vieil édifice social, politique et économique antérieur aux Etats généraux et en même temps à en conserver une autre. Voilà ce que l'on peut et doit admettre, mais à une considération près: à chaque nouvelle étape, le ferment destructeur agit avec plus d'efficacité, plus de sûreté et plus de force victorieuse que la tendance conservatrice. Celle-ci, par contre, se montre toujours timide, incertaine, minimaliste pour ce qu'elle désire conserver et prête à accepter de bon gré de nouvelles immolations. En d'autres termes, dès le commencement, un ferment unique travaille à faire de chaque étape — de chaque nuance — un relais passager vers la capitulation globale. La Révolution française existait déjà toute entière dans ses premières manifestations de même que l'arbre est contenu tout entier dans sa semence. Et c'est précisément ce ferment que l'inoubliable Pape Pie VI, prisonnier puis martyr de la férocité révolutionnaire en 1799, remarqua avec lucidité. Deux cents ans après, l'enquête réalisée par une chaîne de télévision française pour savoir ce que pensaient nos contemporains de la culpabilité du Roi et de la Reine (28) permet de croire qu'un grand nombre d'entre eux — même non Français — admettent comme Clémenceau que la Révolution française est un bloc. (28) Le 12 décembre 1988, la télévision française présenta le procès de Louis XVI, offrant aux téléspectateurs l'occasion de prononcer la sentence. Plus de 100.000 personnes se manifestèrent: 55,5% pour l'acquittement, 17,5% pour l'exil et 27% pour la condamnation à mort. Quelque temps après, le 3 janvier de l'année suivante, une autre émission de télévion aborda le procès de Marie-Antoinette en présence de spécialistes et d'historiens de grande compétence. On ne demanda pas cette fois aux téléspectateurs de se déclarer en faveur ou contre la condamnation à mort, mais simplement pour ou contre la culpabilité de la reine. 75% des spectateurs se prononcèrent pour l'innocence et 25% pour la culpabilité. Il est possible de présumer qu'un bon nombre de ceux qui ont ratifié ou ratifient encore aujourd'hui l'exécution du couple royal, la désapprouveraient en elle-même. Mais ils endossent ces régicides parce qu'ils croient voir en eux — dans l'ensemble exubérant des aspects et des contre-aspects du tourbillon révolutionnaire — le seul moyen de sauver la Révolution française, ses «conquêtes», ses «actes de justice», les espérances insensées qu'elle éveilla, bref le «bloc» désordonné et effervescent des idéologies, aspirations, ressentiments et ambitions qui étaient comme son âme. Ainsi se prolonge jusqu'à nos jours cette espèce de «famille d'âmes» qui envisagent comme un acte de justice l'exécution du faible et bienveillant roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Le nombre des adeptes actuels du régicide est étonnamment grand; mais bonne partie d'entre eux n'adhérerait certainement à aucune des nuances de la Révolution française, car ils représentent une étape plus avancée du processus révolutionnaire, une étape différente mais non sans lien avec les nuances exprimées il y a deux cents ans: les écologistes intransigeants, par exemple, qui trouvent injuste de tuer un oiseau ou un poisson n'éprouvent aucune indignation face à l'exécution de Louis XVI et de sa charmante épouse, ils l'approuvent au contraire formellement. A propos de Marie-Antoinette — d'origine autrichienne mais si imprégnée de la culture et de l'esprit français qu'aujourd'hui encore, en France et à l'étranger, elle est admirée comme la personnification des qualités qui, à un degré insurpassable, caractérisent la France — l'historien anglais bien connu Edmond Burke écrivait avec perspicacité:
(29) Edmond Burke « Reflections on the Revolution in France », in Two Classics of the French Revolution, Anchor Books – Doubleday, New York, 1989, p. 89. Montrer et décrire les liens qui unissent au-delà des siècles certaines modalités d'écologisme à la Gironde par exemple, à la Montagne ou même au babouvisme, représenteraient un travail trop ample et trop subtil pour cet ouvrage. Qu'il suffise toutefois de signaler en passant que plusieurs de nos contemporains ont dénoncé dans l'extrêmisme écologique, comme dans d'autres courants en affinité avec lui, la plus récente métamorphose du communisme qui, dans la défunte URSS et ses satellites, semble actuellement soumis à l'«euthanasie». 3. Léon XIII intervient
Ces considérations, familières pour certains de nos lecteurs, sont moins connues pour d'autres en raison de l'oubli lénifiant que le temps dépose sur les personnages, les doctrines, les courants de pensée, les disputes et leur histoire. Il était nécessaire de rappeler ces préliminaires pour bien comprendre la situation à laquelle Léon XIII se trouvait confronté quand il lança la politique du Ralliement et essaya de rassembler autour d'elle les catholiques divisés par leur façon d'apprécier le phénomène révolutionnaire. Depuis 1870, la France vivait sous un régime républicain. Fondée cette année-là, la Troisième République s'affermit en 1873 lorsque l'Assemblée nationale refusa de restituer le trône au prétendant légitime, le comte de Chambord, descendant du roi Charles X. Après la démission du général de Mac-Mahon en 1879, le régime s'inspira de plus en plus clairement des principes révolutionnaires et anticatholiques qui étaient à l'origine de la Révolution française. Etait-il possible au Vatican de trouver une entente avec ce régime? Cette entente serait-elle un accord avec le diable (30)? C'est à cette question brûlante que Léon XIII devait donner une réponse en accédant au trône pontifical en 1878. (30) Voir note 2 de l’Appendice III, C, 2, a. Les catholiques se livraient alors à des polémiques sans fin qui ne revêtaient pas seulement un caractère doctrinal ou historique. La pomme de discorde consistait en l'appréciation de la Révolution française, et notamment de sa politique envers la religion. Certains catholiques défendaient inflexiblement l'ensemble des droits que la tradition née de saint Rémi et de Clovis reconnaissait à l'Eglise. A côté de ces catholiques aux positions religieuses et contre-révolutionnaires inébranlables, d'autres accordaient à la politique antireligieuse de la Révolution française une adhésion mitigée. Ils assumaient ce qu'ils jugeaient être la véritable pensée des Feuillants ou d'une partie des Girondins. D'autres encore montraient plus d'affinité avec la hardiesse antireligieuse de la gauche girondine. Aucun catholique ou presque n'applaudissait cependant l'extrémisme antireligieux de la Montagne. Ces attitudes vis-à-vis de la politique religieuse correspondaient bien souvent à des prises de position analogues dans des domaines strictement politiques. A l'extrême droite se trouvaient les catholiques partisans de la royauté de l'Ancien Régime et de la restauration monarchique par le prétendant légitime, le comte de Chambord. Ils étaient en quelque sorte les héritiers de ceux dont Talleyrand disait, pour en faire la caricature, qu'ils refusaient tout de la Révolution parce qu'ils n'avaient «rien appris, rien oublié (31).» (31) Cf. Jean Orieux, Talleyrand ou le Sphinx incompris, Flammarion, Paris, 1970, p. 638. Les «modérés» en matière religieuse l'étaient aussi fréquemment en matière politique. Leur royalisme coïncidait avec leur catholicisme: ils aspiraient à une religion pâle et à une royauté décolorée. Enfin, il y avait les adeptes d'un gouvernement nettement républicain et de la séparation totale, ou presque, de l'Eglise et de l'Etat. Il s'agissait de républicains qui se prenaient pour des «modérés» et qui, en cela, se distinguaient des autres partisans de la République moins nombreux: les enfants spirituels de la Montagne. Les Montagnards du XIXe siècle affichaient en général un athéisme tonitruant et un républicanisme radical. Clémenceau déclare encore: «Depuis la Révolution, nous sommes en révolte contre l'autorité divine et humaine, avec qui nous avons d'un seul coup réglé un terrible compte le 21 janvier 1793 [décapitation de Louis XVI] (32).» (32) In Cardinal Louis BILLOT, Les principes de 89 et leurs conséquences, Téqui, Paris, p. 33. La République française que Léon XIII trouva en face de lui se maintenait grâce à l'appui politique des partisans du laïcisme radical ainsi que des catholiques timorés qui croyaient sage de faire bonne mine au régime et même céder à quelques exigences de ce laïcisme, espérant obtenir en échange l'arrêt de l'hostilité alors croissante envers l'Eglise. Oubli du passé et de la royauté catholique née du sacre de Clovis, indifférence irritée envers le destin de la noblesse, accueil résigné et souriant des conquêtes du laïcisme, voilà le prix à payer — imaginaient ces catholiques dits centristes — pour que la république assure à l'Eglise des conditions minimales d'existence. Et celle-ci obtiendrait, par son agilité et sa flexibilité en politique, un avenir tranquille. En accédant au trône pontifical, Léon XIII résolut de faire sienne cette politique. Il paya donc le prix déjà mentionné, mais se priva du même coup du soutien des catholiques qui, sur le plan politique, restaient fidèles à la monarchie légitimiste du comte de Chambord et, sur le plan religieux, réclamaient tous, ou presque tous, les droits que la Révolution française avait arrachés à l'Eglise. Ces catholiques, qui conservaient la nostalgie de la stratégie politique de Pie IX, étaient les fidèles les plus fervents, les plus enthousiastes de la Papauté et les plus intransigeants dans la défense des dogmes. La politique spécifique de Léon XIII poussait au découragement. Et l'on vit décroître alors l'aide apportée par cette phalange de braves qui avaient accepté le coeur léger les persécutions et préjudices de tous ordres causés par la révolution de 1789, et s'étaient sacrifiés pour l'autel et pour le trône, pour Dieu et pour le Roi. Léon XIII était en revanche applaudi par de nombreux catholiques qui négligeaient l'importance de l'interaction existant entre les grands problèmes temporels et spirituels, ainsi que par les catholiques désireux d'accommodement. «Le jeu en valait-il la chandelle?» Beaucoup se posaient la question. Léon XIII voulut prouver que oui. Par le «toast d'Alger (33)» et l'encyclique Au milieu des sollicitudes, il mit le cap clairement et directement vers un compromis qui n'impliquât — le Pape le souligna avec soin — la renonciation d'aucun principe de foi ou de morale enseigné par ses prédécesseurs ou par lui-même. (33) En novembre 1890, l'escadre française de Méditerranée jeta l'ancre dans le port d'Alger. Le cardinal Lavigerie —archevêque de cette ville et une des principales figures sur lesquelles Léon XIII comptait pour mettre en oeuvre sa politique de ralliement en France — offrit aux officiers un banquet dans sa résidence. L'amiral Duperré, commandant cette force navale, fut reçu aux accents de la Marseillaise, jouée par les élèves des fameux Pères blancs (religieux voués à l'apostolat en Algérie). Ce chant révolutionnaire n'était pas encore reconnu comme hymne national par la fine fleur du royalisme français. Au dessert, le cardinal se leva, imité par ses invités. Il lit le texte d'un toast entièrement écrit. Après quelques mots courtois envers ses hôtes, il les exhorta à accepter la forme républicaine de gouvernement, leur assurant que «lorsque la volonté d'un peuple s'est nettement affirmée, que la forme d'un gouvernement n'a rien en soi de contraire, comme le proclamait dernièrement Léon XIII, aux principes qui seuls peuvent faire vivre les nations chrétiennes et civilisées» — cette forme de gouvernement mérite une «adhésion sans arrière-pensée». Quand le cardinal eut terminé, les officiers invités, en grande majorité monarchistes, restèrent stupéfaits et silencieux, sans applaudir. Tous s'assirent à nouveau. Le cardinal se tourna alors vers l'amiral et lui demanda: «Amiral, ne répondrez-vous pas au cardinal?» L'amiral Duperré, vieux bonapartiste, répondit seulement: «Je bois à Son Eminence le cardinal et au clergé d'Algérie». Cette attitude du cardinal Lavigerie, quoique soutenue et approuvée par Léon XIII, eut des répercussions très défavorables dans les milieux monarchistes et catholiques de France, et même dans l'épiscopat français dont Mgr Lavigerie ne reçut pas l'appui souhaité. (Cf. Adrien DANSETTE, Histoire religieuse de la France contemporaine sous la Troisième République, collection «l'Histoire», Flammarion, Paris, 1951, p. 129-131). Comme c'était prévisible, les discussions entre catholiques augmentèrent en fréquence et en intensité: était-il, oui ou non, licite pour un catholique d'être républicain? Léon XIII définit alors la doctrine de l'Eglise. Mais le brouhaha obscurcit la vue de nombreux polémistes. Et différentes positions erronées apparurent chez les catholiques; quelques unes furent rectifiées plus tard par Léon XIII, d'autres par saint Pie X. En résolvant en thèse le problème des catholiques vis-à-vis de la forme de gouvernement, Léon XIII n'alla pas jusqu'à formuler explicitement la distinction entre la république révolutionnaire, issue de la Révolution française, et la forme républicaine de gouvernement, considérée uniquement dans ses principes abstraits et pouvant être légitime selon les circonstances inhérentes à chaque pays. De ce flou, peut-être voulu par le Pape dans un souci de circonspection, résulta en grande partie la confusion sur ce sujet (34). (34) Dans ses divers enseignements sur les formes de gouvernement, Léon XIII n'a pas manqué de traiter des circonstances concrètes dans lesquelles se trouvait la France de son temps. Il déclara même plus ou moins formellement qu'il était persuadé que la République était apte à promouvoir le bien commun dans la France de l'époque. Il était en outre persuadé — il ne le cacha pas — que la plupart des chefs républicains n'avaient aucune animosité envers l'Eglise mais lui étaient hostile à cause des attaques que la République subissait de la part de nombreux catholiques dévoués à la cause monarchique. Aussi, à partir du moment où le Souverain Pontife, suivi par un nombre croissant de fidèles, se réconcilierait sérieusement avec la république, les leaders républicains entameraient, par réciprocité, une politique de conciliation avec l'Eglise. Les événements ne confirmèrent pas les espérances du Pape. Il le reconnut avec amertume dans la lettre qu'il adressa au président de la République, Emile Loubet, en juin 1900:
Par conséquent, le nombre de catholiques français qui, en vertu de la doctrine et de l'esprit de l'Eglise, préféraient comme idéal le gouvernement monarchique — tempéré par la participation au pouvoir de l'aristocratie et du peuple — diminua. Ils se résolvaient à accepter, sans scrupule de conscience, un gouvernement républicain à condition que celui-ci s'avérât nécessaire au bien commun. En revanche, les adeptes de la forme républicaine augmentaient en nombre, moins convaincus de la nécessité d'une république pour la France que du faux principe selon lequel la suprême règle de justice sociale est l'égalité (35). Pour ceux-ci, seule la démocratie, et donc la république intégrale, réalisait la justice parfaite dans le cadre d'une morale parfaite: c'est précisément l'erreur condamnée par saint Pie X dans sa lettre apostolique Notre charge apostolique (Cf. Appendice II, 5). (35) Dans une lettre adressée au cardinal Richard, archevêque de Paris, le 23 décembre de la même année, à propos des persécutions que subissaient les congrégations religieuses de la part du gouvernement français, le Pape montra clairement la déception qu'il éprouvait devant l'échec du Ralliement: «Depuis le commencement de Notre Pontificat Nous n'avons omis aucun effort pour réaliser en France cette oeuvre de pacification qui lui aurait procuré d'incalculables avantages, non seulement dans l'ordre religieux, mais encore dans l'ordre civil et politique. «Nous n'avons pas reculé devant les difficultés, Nous n'avons cessé de donner à la France des preuves particulières de déférence, de sollicitude et d'amour, comptant toujours qu'elle répondrait comme il convient à une nation grande et généreuse. «Nous éprouverions une extrême douleur si, arrivé au soir de Notre vie, Nous Nous trouvions déçu dans ces espérances, frustré du prix de Nos sollicitudes paternelles et condamné à voir dans le pays que Nous aimons les passions et les partis lutter avec plus d'acharnement sans pouvoir mesurer jusqu'où iraient leurs excès ni conjurer les malheurs que Nous avons tout fait pour empêcher et dont Nous déclinons à l'avance la responsabilité» (Actes de Léon XIII, Maison de la Bonne Presse, Paris, t. VI, pp. 190-191). De nombreux catholiques continuaient à être préoccupés par la politique menée en France par le célèbre Pontife. Ils estimaient que la plupart des républicains étaient imbus des erreurs doctrinales héritées de l'Illuminisme du XVIlle siècle, notamment de l'égalitarisme radical et de la phobie, d'origine déiste ou athée, contre l'Eglise catholique; et que les démarches pacificatrices de Léon XIII auprès de la République ne démobiliseraient pas la plupart des républicains hostiles à l'Eglise. L'offensive républicaine continua en effet à s'abattre sur celle-ci sous le pontificat de saint Pie X. L'explosion de la Grande Guerre établit, parmi les Français de toutes tendances, l'Union Sacrée contre l'envahisseur. Une trève politico-religieuse s'ensuivit, qui se prolongea d'une certaine façon après la victoire des armées alliées. Afin de ne pas trop rallonger cet appendice, l'auteur s'abstient d'aborder les événements qui ont suivi. Ce résultat n'advint pas seulement en France mais partout en Occident. Des discussions retentirent dans le monde entier et entraînèrent naturellement divisions et confusions parmi les catholiques des pays les plus divers. Divisions qui, en partie, subsistent encore. Comme subsiste d'ailleurs la grande illusion de l'égalitarisme radical, implacablement anti-monarchique et anti-aristocratique. L'élaboration de cet appendice a été guidée par le désir qu'à la lumière des documents pontificaux la clarté et l'union des âmes sur ce point conquissent du terrain. «Dilatentur spatia veritatis» (que s'élargisse le champ de la vérité) doivent ardemment souhaiter tous les coeurs sincèrement catholiques. Et par conséquent «dilatentur spatia caritatis» (que s'élargisse le champ de la charité).
|
||||||||||||